Aldo se sentit revivre. Les vents grisants de l’aventure tourbillonnèrent autour de lui et il se hâta de prendre toutes dispositions pour se libérer. Grâce à Dieu, à Guy et Angelo Pisani, sa maison d’antiquités pouvait se passer de lui !
Son changement d’humeur secoua la torpeur où s’enlisait le palazzo Morosini. La seule à froncer le sourcil fut Cecina, sa cuisinière et sa plus vieille amie. Quand il lui annonça son départ, elle cessa de chanter et bougonna :
– Tu es content parce que tu nous quittes ? C’est aimable, ça !
– Ne dis pas de sottises ! Je suis content parce qu’une affaire passionnante m’attend et qu’elle me changera du train-train quotidien.
– Train-train ? Si tu m’écoutais un peu plus, tu n’en souffrirais pas. Ne t’ai-je pas conseillé plusieurs fois un petit voyage ? Ton air accablé m’agaçait tellement !
– Tu devrais être contente alors ? Je vais voyager !
– Oui mais pas n’importe où ! Moi, je t’aurais bien vu aller... à Vienne, par exemple ?
Morosini considéra sa Cecina avec un sincère ahurissement.
– Pourquoi Vienne ? Je te signale qu’on y étouffe l’été.
Cecina se mit à jouer avec les rubans qui ornaient sa coiffe et voltigeaient souvent au-dessus de son imposante personne au rythme de ses enthousiasmes ou de ses colères.
– En été, on étouffe partout, et moi j’ai dit ça comme j’aurais dit Paris, Rome ou Vichy ou...
– Ne te creuse pas la tête, c’est justement à Vienne que je vais. Ça te va ?
Sans autre commentaire, Cecina reflua vers ses cuisines en s’efforçant de cacher un sourire qui laissa Morosini perplexe mais, sachant bien qu’elle n’en dirait pas plus, il balaya la question et s’en alla veiller à ses bagages.
Ignorant s’il pourrait séjourner à Vienne après le rendez-vous, il s’en alla trois jours avant la date fixée afin de se donner le loisir de flâner dans une ville dont il avait toujours apprécié l’élégance et l’atmosphère de grâce légère, entretenue par l’écho d’une valse traînant dans quelque coin.
Le temps était maussade, pourtant Morosini se sentait allègre quand son train atteignit la vallée du
Danube et approcha de Vienne. Inexplicable selon la raison, cette humeur heureuse ! Les souvenirs de fête d’avant la guerre n’y étaient pour rien et pas davantage ceux des deux voyages – d’affaires uniquement ! – effectués dans la capitale autrichienne depuis la fin des hostilités qui avait entraîné sa libération d’une vieille forteresse tyrolienne. Après tout, peut-être était-ce seulement parce que, refusant de s’interroger, il évitait de s’avouer que Vienne représentait autre chose qu’un point de départ sur la piste d’un joyau disparu. Ne lui arrivait-il pas d’entendre parfois, au fond de sa mémoire, une voix joyeuse qui lui lançait : « Je vais passer Noël à Vienne, chez ma grand-mère » ?
Étant donné le nombre des grand-mères vivant dans la capitale autrichienne, cette brève information eût été un peu mince, mais Morosini possédait une mémoire infaillible. Un nom entendu s’y trouvait enregistré et, dans le hall du Ritz à Londres, Moritz Kledermann, le père de Lisa, avait prononcé celui de la comtesse von Adlerstein. Découvrir son adresse serait sans doute assez simple et Aldo était décidé à lui rendre une petite visite. Ne fût-ce que pour apprendre d’elle des nouvelles d’une précieuse collaboratrice perdue de vue un peu trop brusquement. Bien sûr, il n’aurait pas fait le voyage pour cela mais, puisque l’occasion lui en était offerte, ce serait bien stupide de n’en pas profiter, le cas Mina-Lisa était presque aussi intéressant que les péripéties engendrées par le pectoral.
Lorsque Morosini débarqua du train à la Kaiserin Elisabeth Westbahnhof, la pluie se déversait d’un ciel bouché, ce qui n’empêchait pas le voyageur de siffloter un allégro de Mozart quand il s’engouffra dans le taxi chargé de le conduire à l’hôtel Sacher. Une maison qu’il aimait beaucoup...
Véritable monument à la gloire de l’art de vivre viennois, aimable souvenir aussi de l’Empire austro-hongrois, le Sacher portait le nom de son fondateur, ancien cuisinier du prince de Metternich, et dressait juste derrière l’Opéra sa silhouette cossue, construite dans le plus pur style Biedermeier et où, depuis 1878, s’engouffrait tout ce que l’empire comptait d’illustre dans le domaine des arts, de la politique, de l’armée et de la gourmandise, joint à nombre de notoriétés étrangères. S’y attachait toujours le souvenir des soupers fins de l’archiduc Rodolphe, le tragique héros de Mayerling, de ses amis et de ses belles compagnes. Pourtant, cette ombre altière et romantique n’apportait aucune note triste à un établissement dont l’autre élément glorieux était un magnifique gâteau au chocolat fourré à la confiture d’abricot et servi avec de la crème fouettée dont la renommée avait déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Frau Anna Sacher, dernière femme de la lignée, menait cette belle maison d’une main de fer dans un gant de velours, fumait des cigares de La Havane, élevait des carlins peu souriants et, en dépit de l’âge et d’un tour de taille enveloppé, savait encore comme personne faire la révérence devant une altesse royale ou impériale.
Ce fut elle que Morosini vit apparaître au seuil des salons quand il fit son entrée dans le hall décoré de plantes vertes et de deux statues plus grandes que nature d’allégories féminines aux seins robustes. N’étant qu’un modeste prince, Morosini n’eut droit qu’à l’honneur de baiser une main dodue comme il l’eût fait avec n’importe quelle maîtresse de maison l’accueillant chez elle. Cette présence féminine était l’un des charmes de l’hôtel : Anna Sacher savait y recevoir chacun selon son rang et, quand il s’agissait d’habitués, ils étaient traités en amis. Ce fut le cas de Morosini. Sous les crans serrés de la chevelure argentée, le visage toujours frais mais un peu lourd s’éclaira d’un joyeux sourire :
– Vous voir arriver est aussi agréable que si vous apportiez avec vous le beau soleil de l’Italie, Excellence. Je suis heureuse de pouvoir, une fois encore, vous souhaiter la bienvenue au seuil de cette maison.
– J’espère bien que vous me la souhaiterez encore à de nombreuses reprises, chère Frau Sacher.
– Qui peut savoir sinon Dieu ! Et je ne rajeunis pas. Nous restez-vous quelque temps ?
– Aucune idée. Cela va dépendre de l’affaire que je viens traiter. Mais ce n’est pas la seule raison : l’autre est la soirée de mercredi à l’Opéra...
– Ah ! Le Chevalier à la rose ! Admirable, admirable ! Ce sera une grande soirée ! Boirons-nous ensemble la tasse de café rituelle, tandis que l’on monte vos bagages dans votre chambre ?
– Vous avez des traditions charmantes pour vos amis, Frau Sacher. Ce serait pécher que les refuser.
Ils gagnèrent ensemble le Rote Café, un élégant salon tendu de damas rouge et éclairé de lustres à cristaux où l’on s’empressa de leur servir le fameux café viennois, couronné de crème fouettée et suivi d’un verre d’eau glacée, dont l’Autriche raffolait. Morosini aussi. C’était, selon lui, en Europe, le seul café capable de rivaliser avec celui des Italiens, les autres n’étant qu’infâmes lavasses.
En le dégustant, on bavarda de tout et de rien, on vanta Venise mais aussi Vienne où la vie mondaine, en dépit des difficultés financières, reprenait chaque jour davantage. C’était en fait indispensable si l’on voulait continuer à attirer les touristes du monde entier. Vienne sans la musique et la valse ne serait plus Vienne. Au contraire de l’Allemagne, récemment amputée de la Ruhr par la France et qui plongeait chaque jour davantage dans l’anarchie et l’extrémisme, le bastion originel de l’empire des Habsbourg s’efforçait de retrouver son âme, et même de la sauver puisque son chancelier était un prêtre, Mgr Seipel. Cet ancien professeur de théologie, devenu député puis président du parti chrétien-social, était en train de remettre les finances à flots en créant une nouvelle monnaie, le schilling, et en procédant à de sévères économies. En même temps, il s’efforçait d’établir une morale rigoureuse. Ce qui, bien sûr, ne plaisait pas à tout le monde, mais l’Autriche ne s’en tirait pas si mal. Pour sa part, Frau Sacher considérait que le chancelier était un homme de bien.
– Par moments, on se croirait presque revenus au beau temps de notre cher empereur. La vieille aristocratie ose être elle-même...
– A propos de la vieille aristocratie, vous pourriez peut-être m’être secourable, Frau Sacher. Je compte profiter de mon séjour ici pour essayer de retrouver une amie de ma mère, perdue de vue depuis la guerre. Or, vous connaissez non seulement la ville entière mais le Gotha au complet...
– Si c’est en mon pouvoir, vous n’avez qu’à demander...
– Merci beaucoup. Voilà : sauriez-vous me dire si la comtesse von Adlerstein est toujours de ce monde ?
Les sourcils artistement redessinés de la vieille dame remontèrent d’un bon centimètre tandis qu’elle tortillait le motif de perles formant le centre du ruban de velours noir qui lui serrait le cou dans le but illusoire de le retendre.
– Pourquoi ne serait-elle plus vivante ? Nous devons être à peu près contemporaines. Cela dit, dans la haute noblesse formant l’entourage habituel des souverains, j’ai connu plus d’hommes que de femmes...
– Néanmoins, vous connaissez cette dame, pour savoir son âge ?
– En fait, je la connais surtout pour deux raisons : le bruit que l’on a fait, il y a environ vingt-cinq ans, lorsqu’elle a marié sa fille à un banquier suisse sans le moindre quartier de noblesse mais fort riche. Sa position à la Cour se serait même vue compromise si notre pauvre impératrice Elisabeth n’était intervenue. Peu de temps avant sa mort. Elle connaissait assez bien cette famille Kledermann.
– Et l’autre raison ?
– Beaucoup plus commerciale, fit Anna Sacher en riant. Elle a un faible pour notre Sachertorte et ne manque pas d’en faire acheter lorsqu’elle est à Vienne. Ce qui n’est pas le cas en ce moment puisque depuis le début de l’été aucune commande n’est venue du palais de Himmelpfortgasse...
Morsini faillit applaudir tant il était content : la chère dame venait, le plus innocemment du monde, de lui offrir un précieux renseignement : l’adresse qu’il eût été délicat de demander s’agissant de celle d’une amie de sa mère. Il se contenta d’un soupir accompagné d’un sourire mélancolique :
– Eh bien, je n’ai pas de chance ! Il faudra que je me contente de déposer ma carte avec un mot. La comtesse me fera peut-être tenir de ses nouvelles...
– Oh, je suis certaine qu’elle n’y manquera pas ! Elle sera aussi ravie de vous retrouver que je le suis moi-même...
Cela Morosini en doutait, puisque la grand-mère de Mina-Lasa ignorait tout de son existence.
Le lendemain, dans l’après-midi, il flânait en dépit de la pluie dans Himmelpfortgasse, distante d’environ deux cents mètres de son hôtel. C’était une ruelle comme on en trouve beaucoup dans la ville intérieure, celle qu’enfermaient jadis les remparts que l’empereur François-Joseph avait remplacés par le Ring, le magnifique boulevard circulaire planté d’arbres et de jardins. Et, comme ses semblables, elle était bordée de maisons anciennes et de deux ou trois palais dont l’un surtout attirait l’œil : trois étages de hautes fenêtres au-dessus d’un entresol, un imposant portail cintré de chaque côté duquel des atlantes chevelus soutenaient un admirable balcon de pierre ajouré. Deux portes de côté, plus petites, donnaient accès aux œuvres vives du palais. Un peu étroite – sept fenêtres seulement s’alignaient à chaque étage – cette demeure s’apparentait assez à celles de la haute bourgeoisie du xviii siècle, mais les armes qui timbraient l’auvent sculpté de l’ouverture centrale annonçaient l’aristocratie et, comme une aigle noire perchée sur un rocher s’y étalait sur champ d’or, Morosini n’eut plus le moindre doute : c’était bien la maison qu’il cherchait puisque Adlerstein signifiait la pierre de l’aigle.
Un long moment, le promeneur resta en contemplation sans qu’aucun des rares passants y attachât d’importance : dans cette superbe ville, les visiteurs s’arrêtaient à chaque pas pour admirer tel ou tel édifice. Aucun signe de vie derrière les doubles fenêtres jusqu’à ce qu’un homme sortît par l’une des petites portes, un panier au bras : sans doute un serviteur allant faire quelques achats et, du coup, Morosini se décida : en trois enjambées rapides, il eut rejoint son objectif :
– Veuillez m’excuser, dit-il en allemand, mais j’aimerais savoir si ce palais est bien celui de la comtesse von Adlerstein.
Avant de répondre l’homme s’accorda le temps de jauger cet étranger élégant dont l’allure n’était pas celle de tout le monde. L’examen dut être satisfaisant car il laissa tomber :

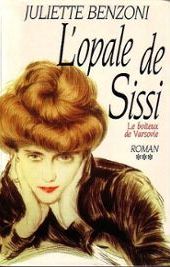
"L’Opale de Sissi" отзывы
Отзывы читателей о книге "L’Opale de Sissi". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "L’Opale de Sissi" друзьям в соцсетях.