– C’est une joie de vous revoir, mon cher maître ! Comment vous portez-vous ?
– Bien, bien... merci, mais c’est à vous, prince, qu’il faut demander cela...
– Ne me dites surtout pas que j’ai mauvaise mine : Cecina s’en est chargée en se jurant d’y mettre bon ordre. Venez vous asseoir ! ajouta-t-il en désignant un fauteuil tendu de vieux cuir avoisinant un tabouret en X qu’il se réservait. Vous n’avez pas changé ! conclut-il en considérant l’aimable visage au nez rond coiffé d’un lorgnon qui s’érigeait sur un impeccable faux col glacé dont la vue avait dû réjouir l’âme de Zaccaria. Morosini aimait bien maître Massaria. Ses moustaches et sa barbiche poivre et sel appartenaient peut-être à un siècle révolu comme son cœur candide et sa conscience scrupuleuse, mais c’était aussi un homme fort entendu dans sa charge, un conseiller financier avisé, assez redoutable même, et un vieil ami de la famille. Son attachement fidèle et silencieux à la mère d’Aldo n’était un secret pour personne ; pourtant, nul ne se fût avisé d’en sourire parce que c’était plutôt touchant.
Sous le prétexte d’un farouche amour de sa liberté, Pietro Massaria ne s’était jamais marié, ce qui lui avait permis d’éviter les unions successives que son père tentait jadis de lui imposer, mais en fait il n’avait jamais aimé qu’une seule femme au monde : la princesse Isabelle. Ne pouvant espérer – et pour cause ! – en faire son épouse, encore moins sa maîtresse, le notaire avait choisi d’être son très fidèle et très discret serviteur, gardant pour seul trésor, dans le secret d’un coffre toujours fermé à triple tour, un petit portrait peint par lui-même à partir d’une photographie et près duquel, chaque matin, il plaçait une fleur fraîche.
La mort brutale de celle qu’il chérissait l’avait écrasé. Aldo s’en aperçut en l’examinant plus attentivement. En dépit de ce qu’il avait dit tout à l’heure, le petit notaire portait plus que ses soixante-deux ans. Son corps replet se tassait et, derrière les verres du lorgnon, les paupières rougies dénonçaient des larmes trop fréquentes.
– Eh bien ? Quel bon vent vous amène ? fit Aldo. Je suppose que vous avez quelque chose à me dire...
– ... pour vous tomber dessus dès le matin de votre retour ? Je vous ai vu arriver et je tenais beaucoup à être le premier de vos amis à vous souhaiter la bienvenue. Et puis, j’ai pensé que plus tôt vous seriez mis au courant de vos affaires mieux ce serait. Je crains que le vent auquel vous faites allusion ne soit pas des meilleurs, mais vous avez toujours été un jeune homme énergique, et je suppose que la guerre vous a habitué à regarder la vérité en face ?
– Elle n’y a pas manqué ! fit Morosini d’un ton allègre qui cachait assez bien l’inquiétude semée par un préambule si peu rassurant. Mais buvons d’abord quelque chose ! Ce sera la meilleure manière de renouer nos bonnes relations...
Il alla ouvrir un cabaret ancien posé sur une console, y prit deux bulles de verre gravé d’or et un flacon assorti empli aux trois quarts d’un liquide ambré.
– Le tokay de mon père ! annonça-t-il. Vous l’aimiez, je crois ? Et on dirait que Zaccaria a traité ce flacon comme la Sainte Ampoule : il n’y manque pas une goutte !
Il servit son hôte puis, son verre entre les doigts, s’installa sur son tabouret mais laissa son vieil ami déguster avec onction le vin hongrois qui lui rappelait beaucoup de bons moments, but une gorgée qu’il roula un instant sur sa langue avant de l’avaler et déclara :
– Eh bien, me voilà prêt à vous entendre ! Cependant... je voudrais que nous évitions autant que possible de parler de mère. Je... je ne puis encore le supporter.
– Moi non plus... J’ai beaucoup de peine.
Pour se remettre, Massaria avala un bon tiers de son verre puis, tirant son mouchoir, il essuya son lorgnon, le remit sur son nez et enfin, avec un tremblement des lèvres qui pouvait passer à la rigueur pour un sourire, il glissa vers son hôte un regard contrit :
– Pardonnez-moi ! À mon âge, les émotions sont facilement ridicules.
– Je ne trouve pas, mais parlons affaires ! Où en suis-je ?
– Pas au mieux, je le crains ! Au moment de la mort de votre père, vous le saviez déjà, les finances...
– ... avaient subi des dégâts, fit Morosini avec un rien d’impatience. Je n’ignore pas non plus qu’au début de la guerre, nous n’avions plus la fortune d’autrefois et j’en suis en partie responsable. Aussi, mon cher maître, épargnez-nous les approches lénifiantes et dites-moi ce qui me reste.
– Ce sera vite fait. Un peu d’argent venant de... votre mère, la villa de Stra, mais elle est hypothéquée jusqu’au paratonnerre, et ce palais qui, lui, est net !
– C’est tout ?
– À mon grand regret... mais si j’ai tenu à vous voir si vite c’est parce que j’ai peut-être un remède...
Aldo n’écoutait pas. Songeur, il était allé reprendre le flacon de tokay et se dirigeait avec lui vers la cheminée après l’avoir offert au notaire qui refusa de la main. Il s’efforçait de faire contre mauvaise fortune bon visage mais, en réalité, il se sentait accablé : son palais, l’un des plus grands de Venise, nécessitait des sommes considérables pour son entretien car, outre l’érosion dont souffrait la cité des eaux, il avait besoin d’un personnel nombreux et, quand la villa de l’arrière-pays – construite par Palladio – serait vendue, il ne resterait sans doute pas grand-chose pour entretenir la maison principale une fois les hypothèques payées. Conclusion : il fallait trouver – et vite ! – une occupation lucrative.
Mais quoi ? À part monter à cheval, chasser, danser, jouer au golf, au tennis et au polo, barrer un voilier, conduire une voiture, baiser avec élégance le métacarpe des patriciennes et faire l’amour, Aldo était bien obligé de s’avouer qu’il ne savait rien faire. Mince bagage pour entamer une carrière et se renflouer ! Restait certain trésor familial dont il était seul, avec sa mère, à connaître le secret mais l’idée de le mettre en vente lui déplaisait : Isabelle Morosini l’aimait tant !...
Accoudé à la cheminée, les yeux dans les flammes, il se versa un troisième verre qu’il avala d’un trait :
– Vous ne songez pas, j’espère, à vous noyer dans la boisson, émit le notaire avec un rien de sévérité. Il y a un instant, je vous disais que j’apportais peut-être un remède à vos maux mais vous ne m’avez pas écouté.
– C’est vrai. Veuillez me pardonner !... Vous auriez une solution ? Laquelle, mon Dieu !
– Un mariage. Très honorable, rassurez-vous, sinon je n’aurais pas pris sur moi de vous le proposer...
Les yeux du prince, dont la forme s’étirait vers les tempes, s’arrondirent :
– J’ai mal entendu ?
– Vous avez très bien entendu, au contraire ! Mariez-vous et je vous promets une belle fortune !
– Rien que ça ? Vous avez bien fait d’annoncer qu’il s’agissait d’une proposition honorable ! Cela élimine le clan des douairières aux veines refroidies et des veuves en mal de solitude... mais pas des laiderons incasables.
– Qu’allez-vous chercher là ? A trente-cinq ans on épouse une jeune fille.
– Vraiment ? fit Aldo narquois. Eh bien, parlez-m’en ! Vous en mourez d’envie et je ne vous ferai pas la peine de vous en empêcher.
– Oh, c’est facile : dix-neuf ans, la fraîcheur d’une rose et les plus beaux yeux du monde... pour les avantages les plus évidents selon la rumeur.
– Ce qui veut dire que vous ne l’avez pas vue ? Et d’où la sortez-vous ?
– De Suisse !
– Vous plaisantez ?
– Voilà une question un peu cruelle pour les Suissesses ! Vous n’ignorez pas, je pense, qu’il en est de fort belles ? Mais voici de quoi il retourne : le banquier zurichois Moritz Kledermann a une fille unique, Lisa, à laquelle il ne refuse rien. On la dit charmante et sa dot a de quoi faire rêver même un prince régnant !
– Ce n’est pas une référence. À l’heure actuelle, il doit y en avoir quelques-uns qui tirent le diable par la queue.
– Ce n’est pas non plus une sinécure d’occuper un trône ! Quant à Lisa, elle serait tombée amoureuse...
Morosini eut un joyeux éclat de rire :
– Comme c’est romantique ! Elle serait amoureuse de moi... mais sans doute pour m’avoir vu, en mon beau temps, dans quelque magazine d’avant guerre. Et comme je ne me ressemble plus...
– C’est une manie de m’empêcher de finir mes phrases ? Il n’est pas question de vous mais de Venise.
– De Venise ? fit Morosini, si visiblement vexé que le notaire se permit de sourire.
– Eh oui, de notre belle cité ! De son charme, de ses ruelles, de ses canaux, de ses palais, de son histoire ! fit-il, soudain lyrique. Vous m’accorderez que le fait n’a rien de rare : Mme de Polignac, le prince de Bourbon, lady de Grey, le peintre Daniel Curtis et son cousin Sargent... sans parler des dévots d’autrefois : Byron, Wagner, Browning, etc.
– D’accord mais, dans ce cas, pourquoi votre héritière ne ferait-elle pas comme eux ? Elle n’a qu’à acheter ou louer un palais, s’y installer et jouir de la vie. Il y a ici assez de belles vieilles demeures qui crient « au secours » et cela ne m’obligera pas à l’épouser.
– Elle ne veut pas n’importe quel palais ! En outre, elle se refuse à être une touriste parmi d’autres. Ce qu’elle désire, c’est s’intégrer à Venise, porter l’un de ses vieux noms si riches de gloire, en un mot devenir vénitienne afin que ses enfants le soient aussi !
– On dirait que Guillaume Tell ne fait plus recette ? Après tout pourquoi pas : il y avait déjà pas mal de piquées avant cette foutue guerre, le nombre n’a pas dû en diminuer beaucoup ?
– Cessez de rire, je vous en prie ! Une chose est certaine : vous répondez point par point aux souhaits de Mlle Kledermann. Vous êtes prince et, au Livre d’or de la Sérénissime, votre nom est l’un des plus beaux, tout comme votre palais. Vous jouissez d’une excellente santé – ce qui a sa valeur pour une fille de la saine Helvétie ! – et vous êtes plutôt bien de votre personne...
– Vous êtes bien bon ! Seulement il y a un détail qui n’a pas l’air de vous effleurer : on ne peut pas faire une princesse Morosini d’une Suissesse qui doit être protestante... en admettant que je considère la proposition.
– Kledermann est d’origine autrichienne et catholique. Lisa aussi.
– Vous avez réponse à tout, n’est-ce pas ? Cependant, je me refuse à épouser une parfaite inconnue pour redorer mon blason. Si j’acceptais, je n’oserais plus contempler en face le portrait du doge Francesco. Prenez-moi pour un fou si vous voulez, mais je me suis juré de ne jamais déchoir...
– Serait-ce déchoir qu’épouser une très jolie femme, intelligente et bonne – ces temps derniers elle soignait des blessés dans un hôpital...
Morosini quitta sa cheminée qu’il commençait à trouver trop chaude et vint poser sa grande main ornée d’une sardoine gravée à ses armes sur l’épaule du petit notaire :
– Mon cher ami, je vous sais un gré infini de la peine que vous prenez mais, en toute sincérité, je ne me crois pas encore réduit à ce genre de marchandage. J’aimerais, si je me marie un jour, suivre l’exemple de mes parents, faire un vrai mariage d’amour, dût la fiancée être pauvre comme la fille de Job. Voyez-vous, j’ai peut-être encore un moyen de me tirer d’affaire.
– Le saphir wisigoth de votre mère ? fit Massaria sans sourciller. Ne croyez-vous pas qu’il serait dommage de le vendre ? Elle y tenait tant...
Aldo ne songea même pas à cacher sa surprise :
– Elle vous en a parlé ?
Le sourire du vieil homme se teinta de mélancolie :
– Donna Isabelle a bien voulu me le montrer, certain soir qui fut peut-être le plus doux de ma vie car ce geste de confiance m’assurait qu’elle me tenait pour un fidèle ami. En même temps j’en fus désolé : voyez-vous, votre mère venait de vendre la plupart de ses bijoux pour entretenir le palais et l’idée de se séparer de ce joyau familial la déchirait.
– Elle a vendu ses bijoux ? s’exclama Aldo atterré.
– Oui, et c’est moi qu’en dépit de ma répugnance elle a chargé des transactions, mais le saphir de Receswinthe[i]lui appartient toujours. Quant à vous, il ne vous est donné qu’en dépôt pour revenir à votre fils aîné si Dieu vous donne des enfants. Voilà pourquoi vous devriez examiner un peu plus sérieusement ma proposition.
– Afin de permettre aux petits-enfants d’un banquier suisse de devenir dépositaires d’une pierre royale et plus que millénaire ?
– Pourquoi pas ? Ne faites donc pas la fine bouche ! Vous qui aimez les pierreries, sachez que Kledermann possède une admirable collection de joyaux parmi lesquels une parure d’améthystes ayant appartenu à la Grande Catherine, une émeraude rapportée du Mexique par Cortès et deux « Mazarin[ii]«.

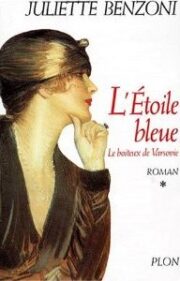
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.