– N’en dites pas plus ! La collection du père pourrait me tenter davantage que la dot de la fille. Vous n’ignorez ma passion des pierres, dont je suis redevable à ce bon M. Buteau ! Je ne tomberai pas dans votre piège. À présent, oublions tout cela et acceptez de déjeuner avec moi !
– Non, je vous remercie. Je suis attendu par le procurateur Alfonsi mais je viendrai volontiers, un soir prochain, goûter aux merveilles de Cecina.
Le notaire se leva, serra la main de Morosini puis, accompagné par lui, gagna la porte de la bibliothèque, et s’y arrêta.
– Promettez-moi de songer à ma proposition ! Elle est, croyez-moi, très sérieuse.
– Je n’en doute pas et vous promets de réfléchir... mais ce sera bien pour vous faire plaisir !
Resté seul, Aldo alluma une cigarette et résista à l’envie de se verser encore un verre. Ce n’était pas un buveur habituel et il s’étonnait de ce besoin soudain. Cela tenait peut-être à ce que, depuis son arrivée, il avait l’impression de se trouver emporté trop vite d’un monde dans un autre. Hier encore, il vivait la vie étriquée d’un prisonnier et, à présent, il retrouvait en même temps sa vie d’autrefois et son ancienne personnalité, seulement l’une lui donnait la sensation d’un vide énorme tandis que l’autre le gênait aux entournures. Il avait tellement souhaité retrouver son cadre familier, ses habitudes peuplées de visages chers ! Et voilà qu’à peine débarqué il devait affronter les misérables soucis de la vie quotidienne ! Au fond, il en voulait un peu à maître Massaria de ne pas lui avoir accordé un plus long délai de grâce, même si la seule amitié avait inspiré sa visite.
Il en venait presque à regretter la chambre glaciale de son burg autrichien où ses rêves au moins lui tenaient chaud tandis que maintenant, rendu aux fastes de sa demeure familiale, il s’y sentait étranger. Quel rapport pouvait exister entre l’amant princier de Dianora Vendramin et le revenant ruiné d’aujourd’hui ?
Car il était bel et bien ruiné, et sans grand remède immédiat. La vente du saphir – en admettant qu’il s’y résigne – lui permettrait peut-être de tenir quelque temps, mais ensuite ? Faudrait-il en venir à vendre aussi le palais et à s’en aller après avoir assuré à Cecina et Zaccaria une pension convenable ? Vers quoi ? L’Amérique, ce refuge des mauvaises fortunes dont il n’aimait pas le style de vie ? La Légion étrangère française où s’était réfugié un de ses cousins ? Il était saturé de guerre. Alors ? L’inconnu, le néant ? ... Il avait une telle envie de vivre ! Restait ce mariage insensé que d’aucuns pourraient juger normal mais qui lui paraissait à lui dégradant, peut-être parce que, avant la grande catastrophe, il avait vu plusieurs de ces unions baroques entre de riches héritières yankees avides de faire broder des couronnes sur leur lingerie et des nobles désargentés incapables de trouver une autre solution. Que la candidate fût helvétique ne changeait rien à la répugnance du prince. S’y ajoutait le fait qu’il y verrait même une mauvaise action : cette jeune fille était en droit d’espérer un peu d’amour. Comment aller vers elle avec l’image de Dianora dans le cœur ?
Agacé de se sentir tenté malgré tout, il jeta sa cigarette dans la cheminée et monta chez sa mère comme il avait coutume de le faire jadis lorsqu’un souci se présentait.
Devant la porte, il hésita encore, se décida enfin, éprouvant un réel soulagement à constater que c’était le soleil qui l’accueillait derrière cette porte et non les ténèbres redoutées. L’une des fenêtres s’ouvrait sur l’air frais du dehors mais un feu clair flambait dans la cheminée. Il y avait des tulipes jaunes dans un cornet de cristal posé sur une commode auprès de sa propre photographie en uniforme d’officier des Guides. La chambre était comme autrefois...
Spacieuse et claire, c’était un chef-d’œuvre de grâce et d’élégance, digne écrin d’une grande dame mais aussi d’une jolie femme. Résolument française avec son gracieux lit à baldaquin rond, ses hautes boiseries claires, ses rideaux et ses tentures de satin brodé qui harmonisaient un ivoire crémeux et un bleu turquoise très doux autour d’un grand portrait de femme qu’Aldo avait toujours aimé. Bien qu’il fût celui d’une duchesse de Montlaure qui, pendant la Révolution, avait payé de sa tête sa fidélité à la reine Marie-Antoinette, il offrait une étonnante ressemblance avec sa mère. Et curieusement, il avait toujours préféré cette toile à celle représentant Isabelle Morosini en robe de bal, peinte par Sargent, qui, dans le salon des Laques, faisait pendant à celle de la grand-tante Felicia due à Winterhalter.
À l’exception du portrait, peu de tableaux occupaient les panneaux d’ivoire rechampis de bleu : une tête d’enfant de Fragonard et un délicieux Guardi, seule évocation de Venise avec quelques verreries anciennes irisées comme des bulles de savon.
Lentement, Aldo s’approcha de la table à coiffer couverte de ces mille riens futiles et charmants si nécessaires à la toilette d’une femme raffinée. Il mania les brosses de vermeil, les flacons de cristal encore à demi pleins, en déboucha un pour retrouver le cher parfum, à la fois frais et sauvage, de jardin après la pluie. Puis, avisant le grand châle de dentelles dont la princesse morte aimait à s’envelopper, il le prit, y enfouit son visage et, se laissant tomber à genoux, il cessa de lutter contre son chagrin et sanglota.
Les larmes lui firent du bien en le vidant de ses incertitudes, en balayant le découragement. Il sut, en reposant le vêtement sur le fauteuil, qu’il n’accepterait pas davantage de laisser une étrangère fouler les tapis de cette chambre que de se séparer du vieux palais familial. Cela signifiait qu’il allait devoir opérer un tri parmi ses souvenirs, établir une échelle de valeurs dont, dès à présent, la conclusion s’imposait d’elle-même : si le joyau pouvait sauver la maison, il fallait s’en séparer. Pas pour n’importe quel acheteur bien sûr : un musée serait peut-être l’acquéreur rêvé mais il paierait moins cher que certains collectionneurs. D’abord, il convenait de récupérer la pierre !
S’étant assuré que la porte était fermée, Morosini s’approcha du chevet du lit et, à l’intérieur d’une des colonnes de bois sculpté soutenant le baldaquin, il chercha le cœur d’une fleur, appuya. La moitié du support peint et doré tourna sur d’invisibles gonds, découvrant la cavité où, dans un petit sac en peau de chamois, la princesse Isabelle gardait le magnifique saphir étoile monté en pendentif. Elle n’avait jamais pu se résigner à le confier à une banque.
Le lit était venu de France avec elle. Depuis plus de deux siècles, il constituait un refuge parfait, à la fois commode et discret, pour ce joyau royal quand le besoin s’en faisait sentir. Ainsi, il avait traversé la Révolution sans que personne se doute de sa présence.
Par piété filiale autant que pour le plaisir de l’avoir toujours sous la main, Isabelle le conservait là. Elle ne s’en parait pas, trouvant la pierre trop importante et trop lourde pour la minceur de son cou. En revanche, elle aimait à le tenir dans ses mains pour chercher à retrouver la chaleur de ces autres paumes évanouies qui l’avaient caressé, jusqu’à celles du roi barbare à cheveux plats dont il ornait le diadème.
La colonne ouverte, le sachet tombait presque de lui-même, cependant cette fois rien ne vint : la cachette était vide...
Le cœur de Morosini manqua un battement tandis que ses longs doigts fouillaient la cavité mais il ne trouva rien et se laissa tomber sur le lit, la sueur au front. Où était passé le saphir ? Vendu ? Impensable. Massaria l’aurait su. Or il avait été affirmatif : la pierre était toujours au palais. Alors ? Sa mère aurait-elle jugé bon de le changer de place ? Aurait-elle préféré une autre cachette ?
Sans y croire, il procéda à une fouille rapide des divers meubles dont aucun n’offrait la sécurité de l’ancienne cache pratiquée par un ébéniste de génie. Il ne trouva rien, revint vers le lit dont il ausculta chaque partie. L’idée lui vint alors que, se sentant mourir, sa mère aurait pu vouloir tenir la pierre une dernière fois et que, d’un geste affaibli, elle l’aurait laissé tomber sans pouvoir la retenir...
Alors, ôtant les tables de chevet, il tira le lit pour le décoller du mur, s’agenouilla et s’aplatit sur le tapis pour explorer le dessous du meuble, si pesant qu’il n’avait pas dû être déplacé depuis son installation.
Quand il eut le nez au ras du sol, l’odeur douceâtre qu’il avait remarquée en pénétrant dans la chambre s’accentua. Apercevant alors un objet qui pouvait être le sac de peau, il engagea son bras jusqu’à l’épaule et réussit à ramener... une souris morte qu’il allait rejeter avec dégoût lorsque quelque chose retint son attention : le corps menu était raide, presque desséché, mais la gueule retenait encore un morceau rougeâtre qu’il identifia aussitôt. C’était un fragment d’une de ces pâtes de fruit à la framboise que sa mère adorait et qu’on lui envoyait de France. Il y en avait toujours quelques-unes dans la bonbonnière de Sèvres posée à son chevet. Il souleva le couvercle de porcelaine dorée : fa boîte était à demi pleine.
Aldo aimait beaucoup lui aussi ces confiseries qui avaient sucré son enfance. Il en prit une dans l’intention de la déguster mais, au même instant, son regard tomba sur le cadavre de la souris. Envahi d’une idée bizarre, il suspendit son geste. C’était une idée insensée, abracadabrante, mais plus il essayait de la chasser et plus elle s’accrochait. Se traitant d’imbécile, il approcha de nouveau le bonbon de ses lèvres mais, comme si une main invisible s’était posée sur son bras, il s’arrêta encore.
– Je dois être en train de devenir fou, marmotta-t-il, mais il savait déjà qu’il ne toucherait pas à cette pâte soudain suspecte. Alors, marchant jusqu’à un secrétaire de marqueterie, il y prit une enveloppe, y déposa la souris, le petit morceau et la framboise intacte, fourra le tout dans sa poche, alla chercher un manteau et dégringola l’escalier en annonçant à Zaccaria qu’il avait une course à faire.
– Et mon déjeuner ? protesta Cecina apparue comme par enchantement.
– Il n’est pas encore midi et je n’en ai pas pour longtemps, je vais chez le pharmacien.
Elle prit feu tout de suite :
– Qu’est-ce que tu as ? Tu es malade ? ... Dio mio, je me disais aussi...
– Mais non, je ne suis pas malade. J’ai simplement envie d’aller dire bonjour à Franco.
– Bon, alors si c’est ça, rapporte-moi du calomel !
Admirant l’esprit pratique de sa cuisinière, Morosini quitta son palais par une porte de derrière et, à pied, gagna rapidement le Campo Santa Margherita où Franco Guardini tenait boutique. C’était son plus ancien camarade. Ils avaient fait ensemble leur première communion après avoir ânonné de concert les grands principes de l’Église sur les bancs du catéchisme.
Fils d’un médecin de Venise fort réputé, Guardini aurait dû suivre la trace de son père au lieu de devenir boutiquier comme celui-ci, indigné et un peu méprisant, le lui avait un jour jeté à la figure mais, passionné de chimie et de botanique alors que les corps de ses semblables ne lui inspiraient qu’un dégoût à peine dissimulé, Franco avait tenu bon même quand le professeur Guardini, tel un ange exterminateur barbu, l’avait chassé de chez lui après une assez vive altercation. Et c’est grâce à la princesse Isabelle, qui appréciait ce garçon sérieux et réfléchi, que Franco avait pu poursuivre ses études jusqu’à ce que la mort de son irascible père l’eût mis en possession d’une confortable fortune. Il avait alors remboursé jusqu’à la dernière lire, mais la reconnaissance qu’il vouait à sa bienfaitrice tenait de la vénération.
Il accueillit Morosini avec le lent sourire qui était, chez lui, le signe d’une joie extravagante, lui serra la main, lui tapa sur l’épaule, s’enquit de sa santé puis, comme s’il l’avait quitté la veille, lui demanda ce qu’il pouvait faire pour lui.
– L’idée que j’aie pu avoir l’envie de te revoir ne t’effleure même pas ? fit Aldo en riant. Mais si tu veux que nous parlions, emmène-moi dans ton cabinet.
D’un signe de tête, le pharmacien invita son ami à le suivre et ouvrit une porte prise dans la boiserie ancienne de son magasin. Une pièce apparut, réduite de moitié par les bibliothèques dont elle était entourée. Au milieu, un petit bureau flanqué de deux sièges. Le tout dans un ordre impressionnant.
– Je t’écoute ! Je te connais trop bien pour ne pas voir que tu es soucieux.
– C’est simple... ou plutôt non, ce n’est pas simple et je me demande si tu ne vas pas me prendre pour un fou, soupira Morosini en sortant son enveloppe et en la posant devant lui sur la table.
– Qu’est-ce que tu m’apportes là ?

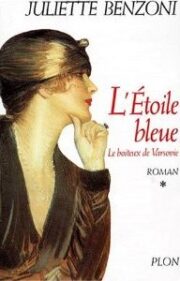
"Etoile bleu" отзывы
Отзывы читателей о книге "Etoile bleu". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Etoile bleu" друзьям в соцсетях.